
Interview Bertrand Coty
Max-Erwann Gastineau, vous publiez aux éditions du Cerf : L’ère de l’affirmation. Quelle est votre vision de la place de l’occident dans le monde qui vient ?
Le monde qui s’ouvre met fin à 400 ans de domination sans partage de l’Occident. Nous vivons donc un véritable basculement ! La guerre en Ukraine l’illustre. Nous pensions isoler la Russie. Or, c’est au final l’Occident qui apparaît isolé. Ses diverses sanctions n’ont pas été approuvées par le reste du monde, y compris par des régimes démocratiques comme l’Inde ou le Brésil. Pour autant, le risque serait de percevoir ce basculement comme illégitime, et de nous recroqueviller sur « nos valeurs », en les agitant comme pour mieux compenser notre perte d’influence politique par un surcroît d’arrogance morale.
Il est dans l’ordre des choses que des pays n’ayant pas la même trajectoire historique que la nôtre, et qui disposent désormais des fruits de leur essor politique et économique, cherchent à faire entendre leur voix. L’Occident doit envisager la « désoccidentalisation », soit la résistance à son influence politique et culturelle, comme une opportunité et un défi. Une opportunité de questionner les raisons de la remise en cause que son modèle – reposant sur la promotion des droits et des libertés de l’individu – peut susciter, y compris en son propre sein.
Une opportunité de nous ouvrir à d’autres représentations du monde qui, que cela nous plaise ou non, vont peser dans la recomposition de l’ordre international. Un défi, car le but n’est pas simplement de prendre acte de cette nouvelle donne. Il est pour les nations européennes, dans un monde multipolaire, de former ensemble leur propre pôle. Les États-Unis ne seront pas toujours là pour nous protéger ni pour défendre l’Ukraine. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024 pourrait très vite le rappeler.
Les valeurs qui ont fait notre force sont aujourd’hui soumises au massacre et à la guerre. Quelle en est la portée historique ?
Plus le monde nous échappe, plus nous brandissons « nos valeurs » tel un étendard censé dérouler le programme de nos ambitions pour l’humanité. De quoi parlons-nous ? Dans mon livre, je rappelle que les valeurs qui ont fait la puissance de l’Europe sont, avant tout, le produit d’un ancrage « géohistorique » singulier, aussi bien façonné par la géographie, le climat que par le christianisme, qui nous a transmis le goût du progrès et de l’innovation (la première révolution industrielle remonte au cœur de l’ère médiévale), la propriété privée et l’idée d’épanouissement personnel, que par le « fait national », qui en divisant l’Europe en États concurrents a généré une émulation sans pareille, source de dynamisme et de volonté de dépassement.
Ce que nous mettons, de nos jours, derrière le mot « valeurs » ne renvoie pas à cet ancrage, mais à nos prétentions universalistes que reflètent les notions de droits de l’homme ou de démocratie. J’y vois deux limites. La première est que, du fait de leur universalité, ces valeurs auraient vocation à s’imposer à tous. Ce qui est totalement contre-productif dans un système international où d’autres manières de voir le monde et de l’habiter, comme en Chine ou à Singapour autour des « valeurs asiatiques », s’affirment.
La seconde est qu’elles font de l’Europe une non-particularité, un monde en miniature ignorant ses propres singularités historiques et culturelles. Cette ignorance de soi, des raisons qui ont fait nos nations, pour reprendre le titre d’un livre de Pierre Manent, n’est pas mère d’ouverture, mais de faiblesse. On le voit face à la barbarie islamiste qui, de nouveau, profite des largesses du Vieux continent pour le frapper. On le voit sur la scène internationale où les Européens, qui ont longtemps cru dans les vertus du droit et du doux commerce pour pacifier les relations internationales, font désormais face à des États sûrs de leur identité, transcendés par la seule valeur qu’ils ont véritablement en commun : l’« intérêt national ». Pensons à l’Inde, dont le « multi-alignement » l’amène à renforcer ses liens stratégiques tant avec la Russie qu’avec l’Occident, l’intérêt national (commercial et sécuritaire) primant toute autre considération.
Quelle est l’urgence pour les nations européennes ?
L’urgence pour les nations européennes est de redécouvrir les sources de leur héritage civilisationnel, ce qui fonde « l’européanité » pour à la fois sortir d’un discours égocentrique, nous enfermant dans une projection idéale et idéologique de notre supposée universalité, et renouveler notre rapport aux autres peuples. Quelle est, par exemple, notre vision de l’Amérique latine ? Nous n’en parlons jamais. Or, de grandes mutations sont en cours. La Colombie a élu pour la première fois de son histoire un président de gauche. Le Mexique s’émancipe sur la scène géopolitique des États-Unis, assumant son ambivalence civilisationnelle de pays à la fois occidental et « indigène ».
L’Europe doit à la fois s’ouvrir et « se replier » pour s’affirmer. Elle doit s’ouvrir pour comprendre les aspirations de nations lointaines, nouer de nouvelles coopérations. Elle doit « se replier », c’est-à-dire retrouver une conscience de soi plus nourrie, capable de conjurer la crise de confiance, la « crise spirituelle » qui touche ses démocraties. « L’Europe est-elle interdite, écrivait Raymond Aron, faute d’une défense commune, par le veto américain ? Ou aussi, et peut-être surtout, par les Européens eux-mêmes, qui nombreux ont perdu leur patriotisme national sans en trouver un autre ? »
En géopolitique, les moyens techniques (armée, technologies, industries) priment, mais ils ne sont jamais que la traduction matérielle d’une raison d’être, d’une conscience spatiale et temporelle claire, incarnée par des frontières, une autorité politique légitime, une souveraineté politique consacrée, une identité collective revendiquée.
Peut-on pratiquer l’introspection quand la colère nous envahit ?
La colère est l’expression d’une émotion que les mots ne permettent plus de contenir. Ce qui arrive dans une situation qui nous dépasse ou que, pour des raisons diverses, nous ne saurions plus tolérer. Elle révèle aussi une faiblesse. Les États-Unis après les attentats du 11 septembre voulaient répondre à la légitime émotion qui saisit le peuple américain. Ils envahirent l’Irak, sans en mesurer les conséquences. Dans les pays non occidentaux, l’invasion américaine de l’Irak, assumée sans le moindre mandat des Nations unies, reste dans les mémoires. Elle fournit la preuve que l’Occident n’hésiterait pas à employer la force au mépris des normes internationales qu’il érigeait par ailleurs en absolu.
Encore aujourd’hui, la Russie joue de ce ressentiment pour renforcer ses positions en Afrique et blâmer l’impérialisme de l’Ouest.
La France a ici une voix à faire entendre. En 2003, au Conseil de sécurité de l’ONU, face à l’aventurisme américain, Dominique de Villepin convoqua l’histoire, celle « d’un vieux pays, la France, d’un vieux continent, l’Europe ». Manière de rappeler que l’expérience, privilège des vieilles nations, est une source inépuisable de leçons qui doivent être sans cesse méditées avant toute action. L’introspection est donc non seulement nécessaire lorsque l’on est remis en cause par les autres, par les pays avec qui nous avons vocation à cohabiter, elle est également indispensable pour éviter de répéter les erreurs passées.
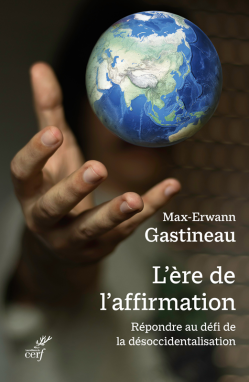
Production BCC – Tous droits réservés 2023

Né en 1988, diplômé en histoire et en relations internationales,Max-Erwann Gastineau a étudié au Canada et à Trinité-et-Tobago,avant de travailler en Chine, aux Nations unies, à l’Assemblée nationale, puis dans le monde de l’énergie. Chroniqueur pour divers médias, il a publié aux Éditions du Cerf un premier ouvrage remarqué, Le nouveau procès de l’Est.

