
Interview Bertrand Coty
Camille Fumard, vous publiez aux éditions CENT MILLE MILLIARDS : « Le leader du XXIe siècle». Comment définiriez-vous les principales vulnérabilités de nos sociétés ?
Ces dernières décennies, nous serions entrés dans une « anthropologie des vulnérabilités », en même temps que le concept de vulnérabilité intégrait les discours techno-scientifiques des démocraties occidentales. Étrange réalité, car la fin du XXe siècle et le tout début du XXIe siècle promettaient au contraire un monde stabilisé grâce à l’accélération de la technologie. Cette nouvelle relation à la vulnérabilité converge avec l’accroissement de l’entropie (augmentation de l’empreinte humaine sur nos écosystèmes).
La première des vulnérabilités relève ainsi du changement climatique. Jusqu’ici nous pensions que nous pouvions maîtriser de plus en plus les effets exogènes. Force est de constater aujourd’hui que la nature reprend ses droits et montre combien sa régulation est liée à la survie de l’humanité.
Nous avons ensuite des vulnérabilités sociales résultant de la montée d’une société que j’appelle « hyperlaxe », autrement dit toujours au bord d’elle-même. Fin des idéologies occidentales – ou ultimes tentatives de faire subsister la dernière en action, à savoir la psyché californienne des yuppies –, nous vivons la chute des valeurs communes. Et nous entrons dans une ère des religiosités fragmentaires, dont les repères sont flous et individualisés. Ce qui provoque des mouvements et des mécanismes de plus en plus polymorphiques et imprévisibles. Cette « société hyperlaxe », sans langage et repères communs, s’ouvre à de nouvelles polarisations. La preuve en est avec la contamination du discours polarisé (qui est propre aux leaders politiques) à celui des leaders économiques, jusqu’ici connus pour pratiquer le langage de la neutralité corporate. C’est le débat par exemple aux États-Unis entre un « capitalisme d’excellence », poussé par les entrepreneurs-Républicains, et un « capitalisme des parties prenantes » (taxé de « woke capitalisme » par les Républicains), conscient des efforts à faire envers la planète et des problèmes d’inégalités sociales.
Il faut par ailleurs avoir une vision plus holistique de la vulnérabilité. Je me suis par exemple intéressée à l’écrivain libano-américain Nassim Nicholas Taleb (dit NNT) qui a théorisé une grille de lecture portée par la notion d’anti-fragilité. En effet, la fragilité renvoie non seulement au vivant, mais aussi aux êtres inanimés. Jamais vraiment évitable, elle est constituante à l’individu et à l’objet. Or, à présent le spectre de la fragilité est à son plein, notamment si l’on observe nos systèmes technologiques. Leur concentration accroît, en effet, la vulnérabilité des réseaux par rapport aux « cygnes noirs », souligne NNT. De la même façon que l’augmentation de l’entropie est une tendance, l’organisation des réseaux autour d’une architecture et de nœuds servant de connexions centrales l’est aussi.
Enfin, la dernière grande vulnérabilité est celle relevant du « problème d’asymétrie », soit celle d’un « peuple au fond du Paradis », d’un monde entre ceux qui ont et ceux qui n’ont rien mais aussi relevant des écarts entre l’adoption des technologies. Nombreux sont les symptômes silencieux de ces écarts, à commencer par le sentiment de ne pas appartenir à un même horizon commun.
Pensez-vous que nous sous-estimions l’incertitude ?
Assurément. Je dirais même que nous refusons l’incertitude. Chute du hasard, mépris de la dispersion et de l’imprévisibilité : tous ces mots, nous les avons repoussés au maximum jusqu’à ce qu’ils relèvent d’une forme de nihilisme collectif. Nous (l’Occident) recherchions en effet abondance, sécurité, prospérité, insouciance et stabilité et pensions que la science et la technique accéléreraient notre maîtrise sur les aléas. Mais ces dernières décennies – à mesure que la complexité du monde s’est aggravée – nous avons en fait dégradé notre « anti-fragilité » en supprimant les résistances, en favorisant les situations de sécurité et soumettant la technique au phénomène d’hypertélie.
Dans mon chapitre 1 « L’idée de Progrès, un malentendu de taille », je reviens sur les causes de ce nihilisme. La principale raison remonte aux années 1930 lorsque nous avons pris pour canevas pour la pensée la logique des mathématiques formelles. Le caractère illusoire de la « puissance de calculabilité », d’un monde du tout calculable et d’un système informationnel total incluant l’individu sont devenus la norme de nos modélisations pour réduire l’écart avec le risque et l’imprévu.
Nous nous sommes pliés à la pensée algorithmique. Cette dernière porte en elle le germe du paradoxe fini/infini selon le théorème d’incomplétude de Gödel, excluant de notre régime de pensée les problèmes dans lesquels des énoncés sont considérés comme pouvant être indécidables. L’incertitude n’a plus sa place.
Aujourd’hui, changer la focale de l’objectif du « tout computationnel » est loin d’être une transition. C’est ce que nous vivons lorsque la finance cherche à intégrer aux données statistiques des modèles économiques classiques : les modèles économiques climatiques. La nature des risques est d’une tout autre ampleur et présente un caractère aléatoire, ce qui pose un véritable défi à la science du prédictible, notamment lors de l’évaluation de la résilience des stratégies des entreprises face aux risques de transition.
Enfin, il faut citer NNT. En effet, il nous invite à considérer la puissance de l’imprévisible, à composer avec l’aléa extérieur, et renvoie l’individu à l’idée de dépassement, ce que j’appelle la « plasticité de la puissance ». Pour lui, les lois normales (ou dites gaussiennes), utilisées majoritairement dans la finance, sous-estiment les niveaux de probabilité d’événements extrêmes, n’expliquent pas la certaine volatilité des occurrences de ces évènements et donc sous-évaluent les niveaux de risque auxquels s’exposent les entreprises. Nous surestimons ce que nous savons et sous-estimons l’incertitude, résume-t-il. Il nous renvoie aux travaux du mathématicien Mandelbrot et aux lois dites de « puissance ». (Voir l’article des Echos : Mandelbrot, l’homme qui aurait pu sauver la finance, 2010). Dans un monde déclaré comme volatile, incertain, complexe et ambigu (acronyme VICA), sa réflexion nous pousse ainsi à « jouer notre peau » et à refonder la morale à l’épreuve du risque.
Quelle place devrait avoir l’engagement dans nos sociétés ?
Aujourd’hui, la place de l’engagement devrait relever de la « tyrannie du collectif » en contrepoids au modèle de leadership de la visée exponentielle (un modèle qui donne aux risques un rôle d’exposant). Ce dernier creuse en effet les écarts de niveaux de vie, considère peu la planète et les impacts sociaux pour favoriser la scalabilité. Pour moi, l’idée d’engagement doit donc inviter à « former mouvement », autrement dit à se mettre en ordre de bataille pour la biodiversité.
L’engagement doit se trouver à toutes les échelles. Concernant l’équité et les « problèmes d’asymétrie », l’État doit être au rendez-vous. Pour la cause climatique et de la biodiversité, ce sont les entreprises et le système financier (en complément des stratégies d’investissement et de décarbonation des États) qui doivent se mobiliser pour passer à l’échelle. Pour les systèmes techniques nous devons investir urgemment dans l’informatique théorique et dans la délocalisation des réseaux. Le terme « engager » ne doit plus uniquement appartenir au vocabulaire du militantisme et des ONG. Il s’agit de l’étendre à tous les champs de pouvoir et de se mettre au diapason, ensemble, pour commencer les transformations nécessaires pour la planète.
L’engagement se veut aussi plus radical. Le contexte l’impose. Pour autant, il faut entendre cette radicalité dans sa signification latine et non anglo-saxonne : Radicalis signifie en latin « qui tient la racine, premier ». Dérivé de radix, radicis : la racine. Cela va de pair avec de nouvelles valeurs comme celle de la persévérance mais aussi la nécessité de coopérer avec la politique et d’afficher son régime de vérité. J’invite dans mon livre à renverser l’image péjorative que l’on donne au mot « radical » pour le changer en vertu. L’engagement se veut loin des ventres mous et proche des mouvements d’émancipation.
Leadership de la bifurcation ou de la visée exponentielle : quelle est la tendance ?
Il est certain que nous allons vers une accélération d’une confrontation future entre ces deux grands modèles de leadership. Si, le leader du XXIe siècle reste en advenir, la tendance va (malheureusement) au leadership de la visée exponentielle. C’est bien pour cela que je titre : « La guerre ne fait que commencer ». La nouvelle classe de dirigeants, celle alignée avec la théorie des parties prenantes, va devoir apprendre comment se forme un mouvement et comment se gagne le combat des idées. Nous avons besoin d’une ardente action collective en faveur de la planète. Cela impose de couper le nœud gordien qui nous maintient dans l’idée d’effondrement du monde parce qu’il serait devenu « VICA » et de s’appuyer sur le registre de l’espoir pour mobiliser le plus grand nombre. L’Occident doit sortir de sa nostalgie.
Reste qu’il est difficile de changer le système, nos modélisations financières et schèmes de pensée. Plus qu’une « transition » environnementale ou sociale, il faut parler de « transformation ». C’est beaucoup plus douloureux et loin de l’idée de traversée.
La principale difficulté a d’ailleurs été expliquée par Mark Carney, envoyé spécial des Nations unies pour l’action climatique. Il s’agit de ce risque appelé « moment Minsky climatique », autrement dit ce moment de basculement vers l’effondrement en cas d’impossibilité de stabiliser la hausse moyenne de la température à 2°C ou d’adaptation trop brutale ou mal conduite à une économie bas carbone. En effet, selon Mark Carney, nous serions pris entre deux paradoxes : celui où « l’avenir sera le passé » et celui où « la réussite est un échec ». Mark Carney revient dans son discours de septembre 2015 sur le second paradoxe (« la réussite est un échec ») moins évident à comprendre. Il explique que des changements trop rapides vers une économie décarbonée peuvent bouleverser la stabilité financière. Or, justement « bifurquer » impose d’aller à la même vitesse que celle du leadership de la visée exponentielle. À cet égard, le monde de la finance utilise des termes renvoyant toujours à la juste mesure, comme celui de « transition ordonnée » ou de « vision pragmatique de l’écologie ». On voit combien nous sommes encore loin de l’ardente action collective nécessaire à la bifurcation !
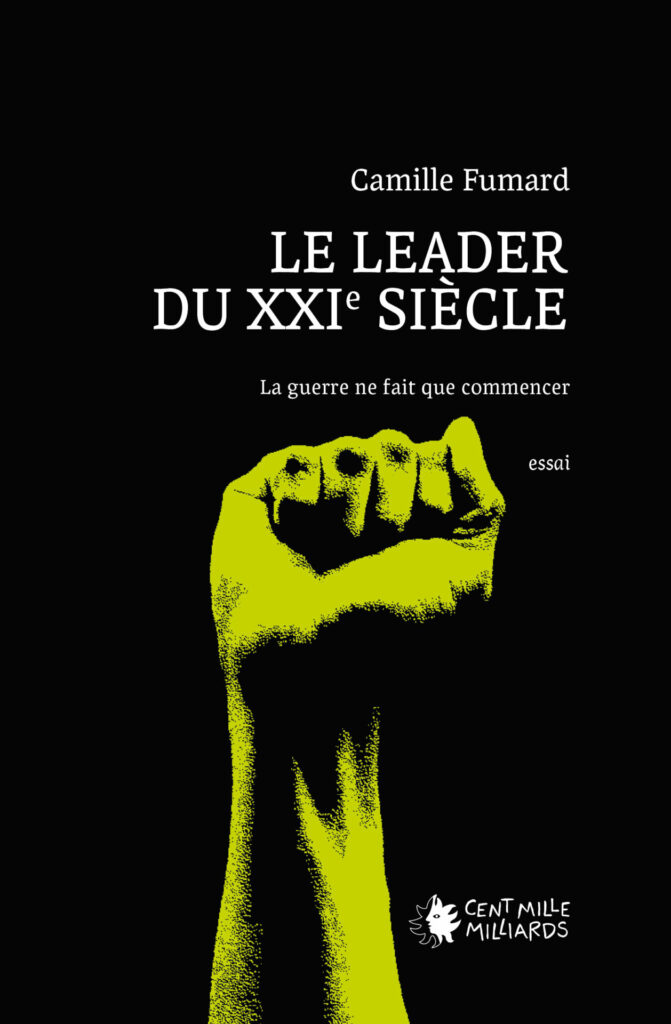
Production BCC – Tous droits réservés 2024

Camille Fumard est directrice conseil et directrice de l’offre C-level, conseillère spéciale auprès du Président du Groupe JIN, agence européenne de conseil en communication, et auteure du récent essai Le leader du XXIe siècle. La guerre ne fait que commencer (Cent Mille Milliards, 2023).

