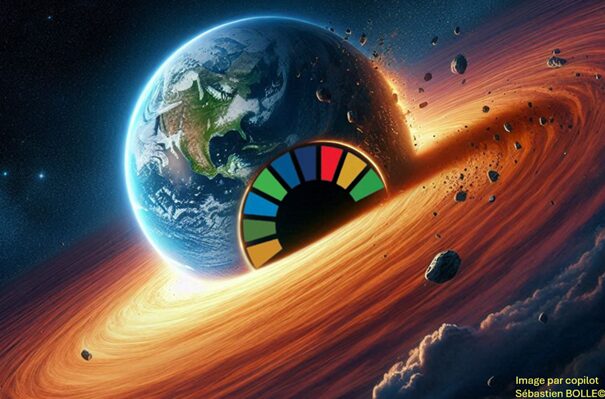
Regards croisés : Quand l’essentiel s’efface
Sébastien Bolle : En ce milieu d’année, une grande partie de la population, attentive aux enjeux de durabilité et soucieuse de son avenir, se retrouve dans une situation de désillusion, voire de chute dans un trou noir. Le concept scientifique du pont d’Einstein-Rosen, cette hypothèse de tomber dans un autre univers à travers un trou spatial, semble malheureusement bien décrire notre réalité face à autant de reculs, d’annulations et de dégradations des trajectoires durables de notre société.
Franck Torres : Pendant que le monde s’effondre à bas bruit, l’entreprise détourne le regard. Elle replie ses ambitions, compresse ses engagements, sacrifie l’essentiel sur l’autel de l’immédiat. La RSE devient invisible au moment même où elle devrait être incontournable. Ce paradoxe n’est pas une coïncidence : c’est un signal faible qui crie fort. Et si on prenait enfin la mesure du moment ?
La RSE 2025 : l’année du trou de ‘vert’ (par Sébastien Bolle)
Pas moins de 43 reculs législatifs ou institutionnels en seulement six mois (1) ! Alors que notre président nous avait placés sur les rails d’une écologie à la française, nous faisons face à des revers majeurs : Zones à Faibles Émissions, réglementations sur les pesticides, reporting extra-financier, utilisation des néonicotinoïdes, Prime Rénov, leasing social pour l’achat de véhicules à basse émission, sauvegarde des océans, etc. Les lobbies anti-transition et anti-“monde d’après” semblent avoir remporté une bataille.
Sur l’autel de la compétitivité et de la croissance, des années d’efforts se sont évaporées. C’est un très mauvais signal envoyé par l’Europe et la France à leurs citoyens, et ce, au plus mauvais moment. François Gemenne, à l’origine de ce constat (2), rappelle que l’inaction coûtera bien plus cher aux entreprises et aux États que la transformation du modèle actuel.
La CSRD, issue du Green Deal, devait permettre aux entreprises de toutes tailles de gérer leurs impacts, risques et opportunités, et de préparer la bifurcation de leurs modèles. Pourtant, la loi Omnibus est venue sonner le glas de ces ambitions, alors même que la Chine (3) se structure autour de ses Chinese Sustainability Disclosure Standards (CSDS). Où sont donc la cohérence, la vision et la stratégie ?
Les enjeux sont (malheureusement) toujours là…
Au cours de la prochaine décennie, entreprises et consommateurs seront confrontés à des défis majeurs en matière de durabilité, chacun représentant à la fois un obstacle et une opportunité pour un avenir plus résilient et conscient. Si nous devions en retenir cinq :
La transition énergétique et la réduction des émissions de CO₂ s’imposent comme une priorité absolue. Avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique, les émissions mondiales doivent chuter de 45 % d’ici 2030. Pourtant, à ce jour, seulement 20 % de l’énergie consommée mondialement provient de sources renouvelables, soulignant l’urgence d’accélérer cette transition.
L’économie circulaire devient cruciale pour minimiser les déchets et optimiser l’utilisation des ressources. Actuellement, moins de 9 % de l’économie mondiale est circulaire. Le volume de déchets électroniques atteint environ 50 millions de tonnes par an, dont moins de 20 % sont recyclés : le besoin de transformation est évident.
La protection de la biodiversité et des écosystèmes est essentielle à la résilience climatique. Un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, et 75 % des écosystèmes terrestres ont été significativement altérés par les activités humaines. 50 % du PIB mondial dépend directement du vivant.
La consommation responsable progresse : 66 % des consommateurs mondiaux sont prêts à payer plus pour des produits durables, mais seulement 26 % des entreprises communiquent de manière transparente sur leurs pratiques. Un écart qu’il faut combler.
L’innovation technologique verte est vitale : les investissements devraient atteindre 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2030, contre environ 600 milliards aujourd’hui. C’est un levier de croissance, d’adaptation, et d’espoir.
Ces enjeux, bien que complexes, constituent une feuille de route pour les acteurs économiques et sociaux. Le Pacte Mondial de l’ONU les rassemble dans son Agenda 2030, ambitieux, mais non négociable si nous voulons relever les défis de demain (4).
Comme toujours dans l’histoire, les avancées ne suivent pas une courbe linéaire. Ces reculs ne signifient ni abandon, ni échec irréversible. Ne faisons pas ce cadeau aux détracteurs de la transition. L’heure d’une nouvelle mobilisation est venue. Massive. Coordonnée. Incisive. Elle viendra de la base. Elle devra porter haut la voix de celles et ceux qui refusent que leurs efforts, leurs engagements, leurs convictions soient sacrifiées.
L’impératif d’une responsabilité sociétale réaffirmée (par Franck Torres)
Traiter aujourd’hui la Responsabilité Sociétale des Entreprises comme une simple variable d’ajustement économique relève d’une insoutenable contradiction morale et stratégique, au moment précis où se multiplient les alertes scientifiques et sociales indiquant une crise globale et systémique majeure : climatique, environnementale et humaine.
Dans le contexte entrepreneurial actuel, nous observons une résurgence des discours centrés sur les fondamentaux économiques classiques : productivité immédiate, rentabilité à court terme et efficacité comptable. L’approche dominante tend à reporter sine die les préoccupations sociétales et environnementales, reléguant ainsi la RSE au rang d’un simple chapitre secondaire dans des rapports périodiques souvent ignorés ou superficiels. Cette attitude, loin d’être neutre, constitue un véritable recul stratégique et éthique.
Ce retrait progressif de la RSE est irresponsable sur le plan sociétal, mais surtout dommageable envers les acteurs internes à l’entreprise, qui aspirent à un modèle économique durable et éthiquement cohérent. Les salariés, en quête de sens et d’intégrité professionnelle, ne peuvent se satisfaire d’une approche réduite à des mesures cosmétiques ou à des compromis moraux permanents. Leur aspiration se porte vers une entreprise transparente, courageuse, capable de placer le durable et l’humain au cœur de sa stratégie et de ses opérations.
En tant que syndicaliste, je constate quotidiennement les effets concrets de cette dynamique négative : désengagement, perte de sens, frustrations croissantes et recherche active de modèles alternatifs. Ces signaux internes ne peuvent être ignorés, car ils traduisent une attente collective forte envers une redéfinition fondamentale du rôle sociétal des entreprises.
Remettre la RSE au centre du projet stratégique des entreprises ne relève pas d’une simple démarche cosmétique. Cela implique une réorientation radicale, fondée sur une prise en compte sincère et systématique des enjeux sociétaux et environnementaux, intégrés au cœur des décisions managériales et opérationnelles.
J’affirme donc l’urgence d’une véritable politisation de la RSE, entendue non pas au sens partisan du terme, mais au sens noble et authentique d’une réflexion collective sur le bien commun. Cette démarche suppose que chaque décision stratégique soit évaluée à l’aune de ses impacts sur l’ensemble des parties prenantes, internes comme externes.
Face aux défis actuels, l’immobilisme ou l’inaction ne peuvent être tolérés. Le moment est venu d’une mobilisation collective positive, portée par les territoires, les syndicats, les citoyens et toutes les entreprises engagées, afin de refuser collectivement la médiocrité stratégique et le cynisme ambiant.
Conclusion commune : Ne pas laisser la lumière s’éteindre
Cet article n’est pas un plaidoyer nostalgique. Il est un appel lucide à la vigilance et à l’action.
À ne pas céder au cynisme. À ne pas se contenter d’un vernis vert sur fond de stratégie grise.
À ne pas céder un centimètre de terrain à celles et ceux qui, par peur ou par inertie, détournent le regard du réel.
Nous croyons en une RSE régénérée, exigeante, ancrée.
Nous croyons en une entreprise qui redonne du sens à l’acte de produire, de diriger, de travailler.
Nous croyons que le changement peut encore s’écrire. Mais il ne se fera pas sans celles et ceux qui décident aujourd’hui de ne plus se taire.
Sébastien Bolle – Président de RESO2D, ambassadeur plateforme RSE de Nantes Métropole.
3 – https://ksapa.org/chinese-sustainability-disclosure-standards-vs-csrd-and-issb/ 4 – https://pactemondial.org/2025/07/01/premiere-etude-des-communication-sur-le-progres-des-engagements-solides-pour-les-entreprises-francaises-un-levier-a-renforcer-pour-laction/



