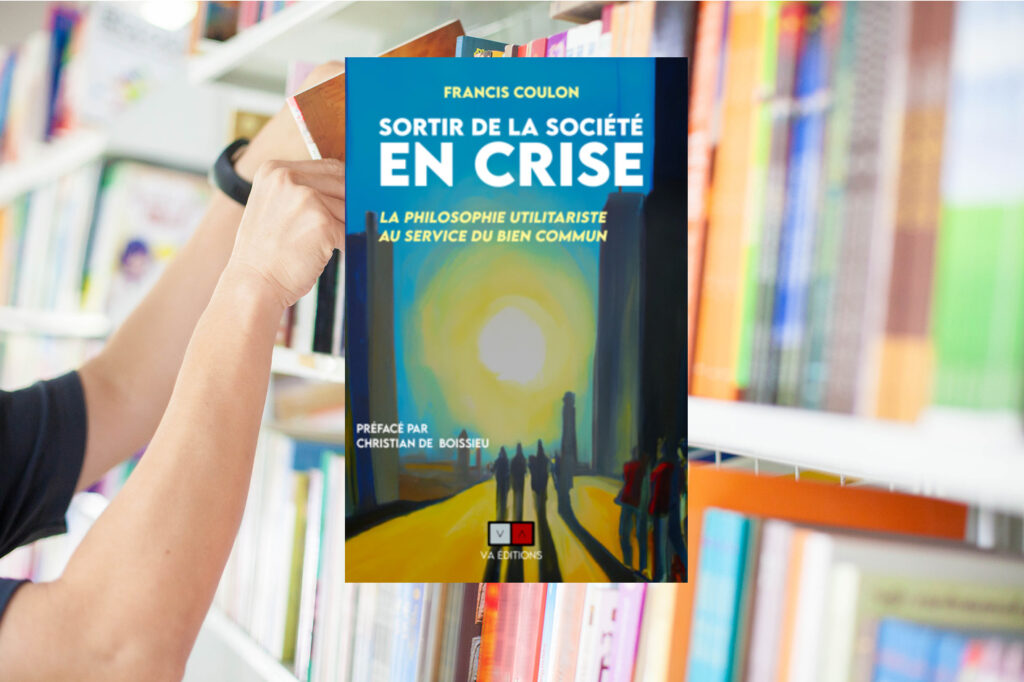
Interview Bertrand Coty
Sur les traces d’une société en mutation, votre livre nous emmène dans une exploration fascinante, de l’âge des Lumières à la démocratie moderne. Vous parlez de société en crise, quelle en est la portée ?
Il y a d’abord une crise au niveau mondial : celle de la transition énergétique, de l’affrontement entre la Chine et les États-Unis, de la montée en puissance des BRICS, des guerres locales. Il y a en plus des problèmes spécifiquement français : nous sommes mal positionnés en matière d’éducation, comme le montrent les classements Pisa et ceux de Shanghai, la pandémie du Covid a montré la fragilité de notre système de santé et la violence est au coin de la rue. Plusieurs études montrent que la France est de plus en plus fragmentée et que notre pays a du mal à « faire société ». D’après le World Happiness Report, les Français ne sont pas heureux, alors que la France a tout pour réussir.
Par rapport à cette évolution, vous proposez de prendre du recul, de chercher à sortir de cette impasse et pour cela vous décrivez les approches de penseurs influents tels que Bentham, John Stuart Mill ou Adam Smith. Votre but est-il de redonner du sens à l’économie politique ?
Nous sommes dans une période de mutation angoissante, mais qui peut aussi s’avérer une opportunité, l’occasion de rebattre les cartes et de rebondir. Cependant nous sommes confrontés tous les jours à des injonctions contradictoires. Faut-il plus de liberté ou plus d’ordre ? L’État en fait-il trop ou pas assez ? Faut-il remettre en cause la démocratie ou au contraire la refonder ? Nous sommes un peu perdus et nous avons besoin de retrouver des repères qui nous diraient « ce qu’il faut faire » et « ce qu’il ne faut pas faire ». Je pense avec Raymond Aron que « La capacité française de discuter abstraitement sur le plan idéologique est une des maladies de l’esprit politique ». J’ai cherché s’il existait une pensée, une philosophie qui serait le plus possible dénuée d’idéologie, d’apriori et qui serait au plus près du réel. Je crois que la philosophie utilitariste est un bon candidat pour accomplir cette tâche.
Vous proposez une véritable réponse aux problèmes que nous rencontrons sur le plan individuel, mais aussi collectif en reconsidérant la philosophie utilitariste, cette pensée très influente dans le monde anglo-saxon. En quoi peut-elle apporter des solutions ?
Cette philosophie, mal connue en France, a contribué à forger le monde dans lequel nous vivons. Je propose de la revisiter, car c’est une approche pragmatique qui examine sans préjugé les conséquences de nos actions. L’utilitarisme se fonde sur un principe central qui est le principe d’utilité, défini ainsi par Bentham : « Le plus grand bonheur, pour le plus grand nombre ». Pour reprendre les termes de Max Weber, « c’est plus une éthique de responsabilité qu’une éthique de conviction ». Par exemple, je critique les politiques qui défendent une sortie de l’Europe en fonction de leurs convictions, sans une analyse sérieuse des conséquences. Mais depuis le Brexit, on entend moins de suggestions allant dans ce sens.
Vous dites que la philosophie utilitariste peut nous aider à partir d’un nombre limité de principes intuitifs et de bon sens. En pratique, comment mettre en œuvre la démarche utilitariste ?
La démarche utilitariste frappe par sa simplicité. Le principe d’utilité revient à faire la balance entre les avantages et les inconvénients d’une décision pour les personnes concernées. On ne s’interroge pas sur les motifs de l’action, mais sur ses conséquences. Un concept clé issu de l’utilitarisme est la recherche de « l’efficience », c’est-à-dire choisir la meilleure utilisation possible des ressources dont nous disposons. C’est une démarche pertinente pour la sphère publique, car les budgets ne sont pas extensibles, il faut donc être efficient et le citoyen peut, à juste titre, demander « d’en avoir pour son argent ».
Votre livre interroge largement sur l’action des gouvernements et vous en donnez de nombreux exemples à partir de problèmes qui se posent à nous aujourd’hui. Quel processus proposez-vous dans la conduite de la politique de la nation ?
Il faut définir les politiques publiques de la manière la plus objective, la plus responsable possible : Les actions doivent être évaluées ex ante (comparer des alternatives) et ex post (contrôler l’atteinte des résultats).
Dans n’importe quelle réforme, qu’il s’agisse de retraite, de chômage, de santé, d’éducation, le gouvernement doit chercher à respecter trois critères « efficacité, justice, liberté » :
1) Est-ce efficace sur le plan économique, la balance coûts/bénéfices est-elle positive ?
2) Avec une répartition juste des avantages, personne n’est-il oublié au bord de la route ?
3) Cette réforme fait elle preuve de souplesse, de flexibilité dans la mise en œuvre, respecte-t-elle les préférences individuelles ?
Je conclurai en citant Michel Foucault : « L’utilitarisme est une technologie de gouvernement ».
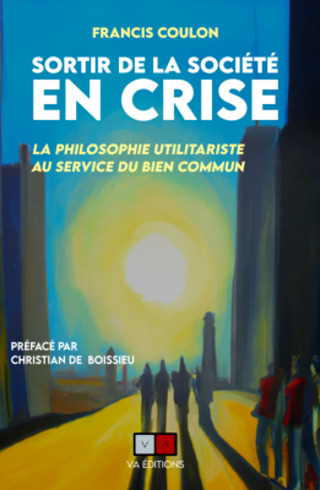
Production BCC – Tous droits réservés 2023

Francis Coulon, après trente ans passés au sein des groupes DANONE et LVMH, est conseil en management et fusion-acquisition. Il a été également professeur dans plusieurs Business Schools. Passionné de philosophie et d’économie, il a publié récemment plusieurs articles sur l’économie et la RSE.

